Nominations, crise, fracture : À qui profite le système sous macron ? Vous allez tout savoir sur la fracture sociale qui fait flamber les réseaux sociaux. Nous voyons sur X aujourd’hui un ras le bol du gouvernement.
Chaque jour Faut qu’on en parle, essai de décrypter les infos politiques sur les réseaux sociaux.
Soutenez faut qu’on en parle
Aidez « Faut qu’on en parle » à grandir ! Plongez dans l’univers des saveurs du Comptoir de Toamasina, spécialiste en vanille, poivres, thés et épices, et profitez de 10% de réduction sur votre première commande avec le code BRÉSIL.
Grâce à votre achat, nous touchons une commission qui nous permet de vivre de notre passion : le vrai journalisme. Un geste simple pour vous, un soutien essentiel pour nous !
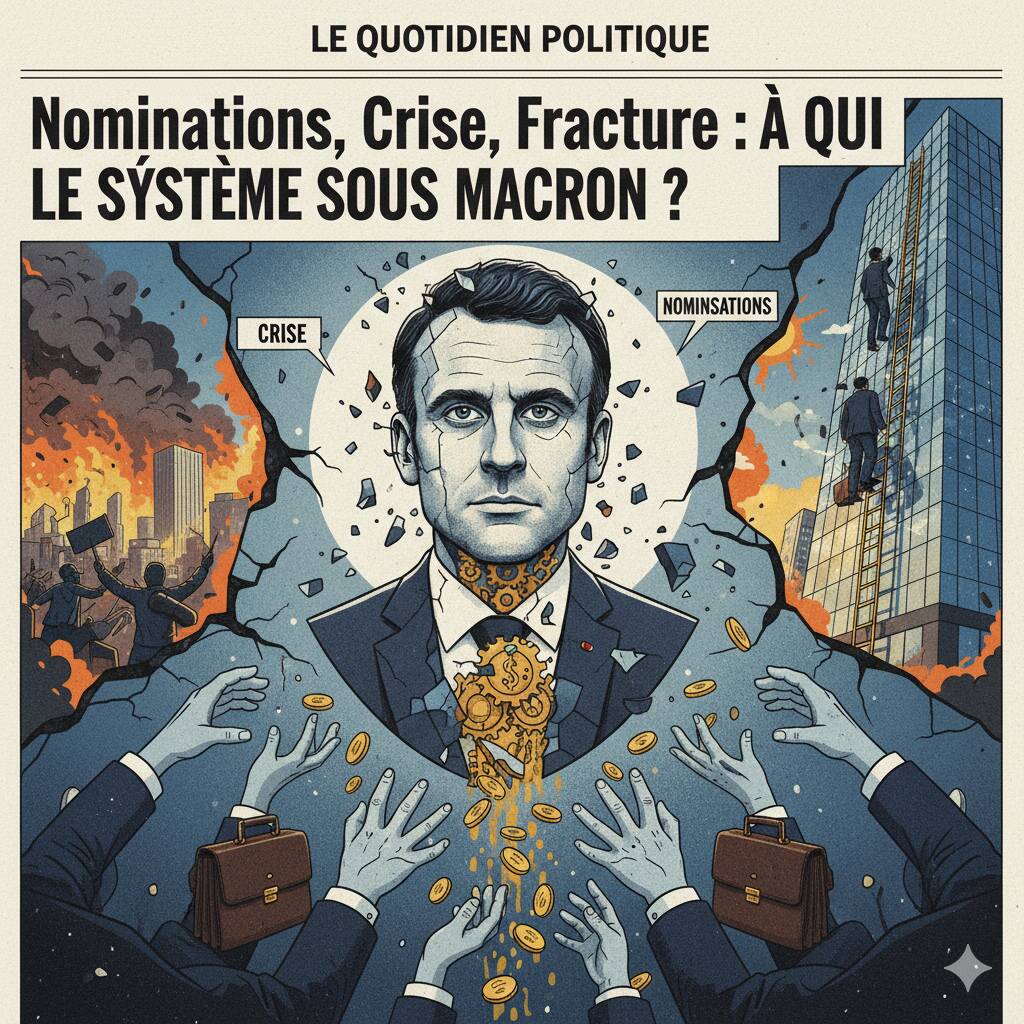
Nominations, crise, fracture À qui profite le système sous macron
Nominations, crise, fracture : À qui profite le système sous macron ?
Le 6 octobre 2025, la Cinquième République a enregistré un nouveau record, aussi bref que dévastateur. En présentant sa démission au président Emmanuel Macron, qui l’a acceptée sans délai, Sébastien Lecornu est devenu le Premier ministre le plus éphémère de l’histoire du régime. Nommé moins d’un mois auparavant, son gouvernement n’aura duré qu’une seule journée. Cet acte, loin d’être un simple accident de parcours politique, a agi comme le révélateur brutal d’une paralysie institutionnelle profonde. L’implosion de l’exécutif n’était pas une cause, mais la conséquence logique d’une machine étatique grippée, incapable de produire le moindre consensus, la moindre stabilité.
Dans le sillage de cette démission éclair, une conséquence immédiate, presque passée inaperçue dans le chaos ambiant, a cristallisé la nature de la crise. Les nominations, pourtant considérées comme imminentes, de deux figures majeures de la haute administration et de la politique aux têtes de fleurons stratégiques de l’État ont été suspendues sine die. Jean Castex, ancien Premier ministre, était pressenti pour prendre la présidence de la SNCF. Marie-Ange Debon, pur produit de l’élite administrative et dirigeante de Keolis, devait succéder à Philippe Wahl à la tête du groupe La Poste. Ces deux nominations, qui auraient dû symboliser la continuité et la puissance régalienne de l’État, sont devenues les otages d’un vide au sommet. L’appareil d’État, si paralysé qu’il ne pouvait plus se doter d’un gouvernement, se révélait également incapable d’accomplir l’une de ses fonctions les plus fondamentales : nommer les dirigeants de ses entreprises publiques.
Cet épisode, en apparence anecdotique, constitue en réalité un microcosme parfait de la polycrise qui ronge la France. Il est le point de convergence d’une crise de gouvernance politique, où l’autorité présidentielle se heurte à un Parlement ingouvernable ; d’une crise de cohésion sociale, exacerbée par des inégalités économiques que les rémunérations de ces postes ne font qu’illustrer de manière criante ; et enfin, d’une crise de légitimité des élites, dont les parcours interchangeables et les nominations perçues comme des récompenses politiques nourrissent un sentiment de défiance généralisé. La « politique des copains », loin d’être une dérive occasionnelle, apparaît ici comme le système d’exploitation par défaut d’une République confrontée à ses propres limites systémiques. L’affaire des postes suspendus n’est pas une histoire de nominations manquées ; c’est le récit d’un État qui, à force de se regarder le nombril, a perdu sa capacité à agir.
Chronique d’une Implosion Politique (Juin 2024 – Octobre 2025)
L’incapacité de l’État à nommer les dirigeants de la SNCF et de La Poste en octobre 2025 n’est pas un événement isolé, mais le point d’orgue d’une séquence politique de seize mois qui a vu les institutions de la Cinquième République se déliter à une vitesse inédite. Pour comprendre ce blocage, il faut remonter à sa source, à l’acte fondateur de cette crise de régime : la dissolution de l’Assemblée nationale.
Le Péché Originel : La Dissolution de Juin 2024
Le soir du 9 juin 2024, face à la victoire écrasante du Rassemblement National aux élections européennes, le président Emmanuel Macron a pris une décision qui allait sceller le destin de la fin de son quinquennat. En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale, il espérait provoquer un « choc de clarification », forçant les Français à choisir entre son bloc centriste et les « extrêmes ». Le pari s’est avéré être une erreur stratégique monumentale. Les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet n’ont pas produit la majorité espérée, mais ont au contraire consacré une tripolarisation du paysage politique, créant un Parlement sans majorité absolue et, de fait, ingouvernable. Aucun des trois blocs – l’alliance de gauche du Nouveau Front Populaire (NFP), le bloc présidentiel Ensemble, et le Rassemblement National (RN) – ne disposait des sièges nécessaires pour gouverner seul, et aucune coalition stable ne semblait possible entre ces forces que tout oppose. Le piège institutionnel était en place.
La Valse des Premiers Ministres : Une Instabilité Chronique
Ce qui a suivi fut une démonstration spectaculaire de l’impasse politique. Le gouvernement de Gabriel Attal, déjà en sursis, a remis sa démission le 15 juillet 2024, ouvrant une période d’incertitude inédite. Pendant près de deux mois, le pays a été dirigé par un gouvernement démissionnaire, cantonné à la gestion des « affaires courantes », une situation sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Après de longues tractations, le président nomme Michel Barnier, une figure de la droite modérée, en septembre 2024. L’objectif était de construire un gouvernement de compromis avec une partie des Républicains. Mais la base parlementaire était trop étroite et l’opposition du NFP et du RN trop forte. En décembre 2024, son gouvernement est renversé par une motion de censure sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, après à peine trois mois d’existence.
Le président Macron s’est alors tourné vers une autre figure du centre, François Bayrou. Son gouvernement, formé en décembre 2024, a tenté d’imposer un budget d’austérité drastique pour 2026, incluant des mesures hautement impopulaires comme la suppression de jours fériés. Refusant toute négociation, Bayrou a engagé sa responsabilité via un vote de confiance le 8 septembre 2025. Le résultat fut une défaite cinglante : 194 voix pour, 364 contre. Le NFP et le RN, unis dans leur opposition, ont fait chuter le gouvernement.
C’est dans ce contexte de décomposition que Sébastien Lecornu, un fidèle du président, est nommé le 9 septembre 2025. Sa mission était de former un gouvernement capable de survivre. Mais après des semaines de consultations infructueuses, le gouvernement qu’il présente le 5 octobre est immédiatement perçu comme mort-né, sans aucune chance d’obtenir la confiance du Parlement. Face à l’évidence de l’échec, il démissionne le lendemain, le 6 octobre, avant même d’avoir pu commencer à gouverner.
La Nation Ingouvernable
Cette succession rapide de gouvernements éphémères a mis en lumière la fragmentation totale du paysage politique français et l’impuissance du président de la République. Le modèle de la Cinquième République, conçu par et pour un exécutif fort s’appuyant sur une majorité parlementaire stable, s’est révélé totalement inopérant dans cette nouvelle configuration. Le système « hyper-présidentiel » français, qui confère des pouvoirs considérables au chef de l’État, est devenu une coquille vide sans le soutien de l’Assemblée. Les outils constitutionnels à sa disposition, comme la nomination du Premier ministre, se sont retournés contre lui, chaque nouvelle nomination échouée affaiblissant un peu plus son autorité.
La crise n’est donc pas simplement le résultat d’une arithmétique parlementaire défavorable ou de l’échec personnel d’Emmanuel Macron. Elle révèle une faille systémique profonde. Dans un tel contexte de paralysie, la tentative de procéder à des nominations stratégiques de premier plan, comme celles de Castex et Debon, apparaît comme une tentative désespérée de réaffirmer une prérogative présidentielle qui n’est plus soutenue par un pouvoir réel. L’échec public de ces nominations, suspendues faute de gouvernement pour les valider, n’est que le symptôme le plus visible de cette impuissance. L’État, réduit à « gérer les affaires courantes », ne pouvait plus prendre de décisions stratégiques, laissant ses plus grandes entreprises publiques dans un état de vacance au sommet, en pleine tempête politique et économique.
Le Cursus Honorum de l’Énarchie : Un Système à Bout de Souffle
Au-delà de la crise politique conjoncturelle, la controverse autour des nominations de Jean Castex et Marie-Ange Debon met en lumière une crise plus structurelle : celle du système de formation et de sélection des élites françaises. Les profils des deux candidats, loin d’être exceptionnels, sont au contraire des archétypes parfaits de la haute fonction publique, dont les parcours illustrent à la fois la force et les limites d’un modèle aujourd’hui largement contesté.
Les Nommés, Produits d’un Même Moule
Marie-Ange Debon incarne à la perfection le cursus honorum de l’élite administrative et économique française. Son parcours est une succession d’étapes quasi obligatoires pour atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Diplômée de deux des institutions les plus prestigieuses du pays, HEC Paris (1986) et l’École Nationale d’Administration (ENA, promotion Jean Monnet, 1990), elle commence sa carrière, comme il se doit, dans un « grand corps » de l’État : la Cour des comptes. Cette première étape lui ouvre les portes d’une carrière qui naviguera avec une aisance remarquable entre le secteur public et le secteur privé parapublic. Elle occupe des postes de direction à France 3, puis au sein du groupe Thomson, avant de rejoindre Suez, un géant des services à l’environnement, où elle gravit les échelons jusqu’à devenir directrice générale adjointe. Enfin, en 2020, elle prend la présidence du directoire de Keolis, une filiale majeure de la… SNCF. Sa trajectoire est un exemple textbook de la circulation des élites, un « pantouflage » parfaitement maîtrisé où les frontières entre le service de l’État et la direction de grandes entreprises à capitaux publics s’estompent.
Le profil de Jean Castex, bien que plus politique, relève de la même logique. Haut fonctionnaire, énarque lui aussi, il a gravi tous les échelons de l’administration préfectorale et des cabinets ministériels avant d’être nommé Premier ministre en 2020. Sa nomination envisagée à la tête de la SNCF s’inscrit dans une tradition bien établie de la Cinquième République : récompenser la loyauté politique et « recaser » d’anciens serviteurs de l’État à des postes prestigieux et lucratifs au sein des entreprises publiques. Cette pratique, souvent qualifiée de « fait du prince », est l’incarnation même de la « politique des copains » dénoncée par les critiques du système. Le choix ne semble pas motivé par une expertise spécifique du transport ferroviaire, mais par un statut et une proximité avec le pouvoir exécutif.
Ces deux parcours, bien que différents, révèlent un ADN commun. Ils sont le produit d’un système qui forme une petite caste de dirigeants, partageant les mêmes codes, les mêmes réseaux et la même vision du monde. Ce système, longtemps perçu comme un gage de compétence et de stabilité pour l’État, est aujourd’hui de plus en plus vu comme un facteur d’endogamie et de déconnexion. Dans une période de forte tension sociale et de défiance envers les institutions, la nomination de figures issues de ce sérail homogène devient politiquement explosive. Elle n’est plus perçue comme le choix des « meilleurs » pour le poste, mais comme la preuve que le système se perpétue en circuit fermé, se cooptant lui-même et renforçant le sentiment d’aliénation d’une grande partie de la population. Le mot « caste », ironiquement contenu dans le nom de l’un des candidats, n’a jamais semblé aussi pertinent.
La Façade du Contrôle Démocratique
Pour légitimer ces nominations décidées au sommet, la Constitution prévoit une procédure de contrôle parlementaire. Selon l’article 13, le pouvoir de nomination du Président de la République pour certains emplois stratégiques, dont les présidences de la SNCF et de La Poste, s’exerce après un avis public des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les candidats sont auditionnés, et les parlementaires votent.
Cependant, un examen plus attentif de la procédure révèle ses limites. La loi organique qui encadre ce pouvoir précise que le Président ne peut procéder à la nomination que si « l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés ». Ce seuil est si élevé qu’il est quasiment impossible à atteindre. De fait, depuis l’instauration de cette procédure, le Parlement n’a jamais exercé son droit de veto sur une nomination proposée par le Président de la République.
Cette réalité transforme les auditions parlementaires en ce que l’on peut qualifier de « théâtre démocratique ». Elles offrent une plateforme publique aux candidats pour exposer leur vision et donnent l’illusion d’un contrôle rigoureux. En pratique, elles servent surtout à entériner des décisions déjà prises à l’Élysée. Le processus conforte la légitimité des personnes nommées plutôt qu’il ne les soumet à un véritable examen critique. Il s’agit moins d’une procédure de sélection que d’un rituel de confirmation, une formalité qui donne un vernis de responsabilité démocratique à des choix qui restent fondamentalement discrétionnaires et liés au pouvoir exécutif. La suspension des nominations de Castex et Debon n’est donc pas due à un sursaut du contrôle parlementaire, mais à l’effondrement de l’exécutif lui-même, seul véritable maître du jeu.
La Question Salariale : Une Fracture Morale et Économique
Au cœur de la controverse entourant les nominations à la tête de la SNCF et de La Poste se trouve une question aussi sensible que symbolique : celle de la rémunération des dirigeants. Dans un pays traversé par une crise sociale profonde et une anxiété croissante face au pouvoir d’achat, les salaires prévus pour ces postes, bien que réglementés, agissent comme un puissant catalyseur de la colère et du sentiment d’injustice. Ils illustrent de manière crue la fracture qui sépare l’élite dirigeante du quotidien des salariés de base.
Les Sommes Princières de la République
Depuis un décret de 2012, initié sous la présidence de François Hollande dans un souci affiché de justice sociale, la rémunération des dirigeants des entreprises publiques est plafonnée. Ce plafond a été fixé à 450 000 euros bruts annuels. Ce qui était à l’époque présenté comme une mesure de modération est devenu, au fil des ans, la norme pour les postes les plus stratégiques de l’État-actionnaire.
Les rapports de l’Agence des participations de l’État (APE) confirment cette tendance. Jean-Bernard Lévy à la tête d’EDF, Philippe Wahl à La Poste, ou encore Guillaume Pépy lorsqu’il dirigeait SNCF Mobilités, percevaient tous une rémunération fixe annuelle de 450 000 euros. C’est ce montant, ou un chiffre très proche, qui aurait constitué la part fixe du salaire de Jean Castex et de Marie-Ange Debon. Ce chiffre, bien qu’inférieur aux standards du secteur privé pour des entreprises de cette taille, représente plus de 23 fois le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) annuel brut, et place ces dirigeants dans les plus hautes strates de revenus du pays.
La politique de plafonnement, conçue pour apaiser l’opinion publique, a eu un effet paradoxal. En institutionnalisant un niveau de rémunération très élevé, elle a transformé ce qui devait être un maximum en un standard, un dû pour quiconque accède à ces fonctions. Dans le contexte de 2025, marqué par l’inflation et la stagnation des bas salaires, ce plafond n’est plus perçu comme une limite mais comme le symbole d’un privilège de caste, déconnecté des efforts demandés au reste de la population.
Sources : Rapports de l’Agence des participations de l’État, Infogram
L’Autre France : La Grille Salariale « Écrasée en Bas »
Le contraste devient saisissant lorsque l’on quitte les sommets de la hiérarchie pour examiner la réalité des salariés de la SNCF. Les discussions sur les forums de cheminots et les analyses syndicales peignent un tableau radicalement différent. La structure salariale de l’entreprise est décrite par ses propres employés comme étant « complètement écrasée en bas ». Les augmentations liées à l’ancienneté ou au changement de position sont si faibles qu’elles peinent à compenser l’inflation, et certains des plus bas salaires de la grille tombent régulièrement sous le niveau du SMIC avant que des ajustements ne soient effectués.
Les chiffres concrets sont éloquents. Selon des simulations internes partagées par des salariés, un agent en début de carrière à la « Position 4 » peut espérer un salaire net mensuel d’environ 1 243 euros, prime de travail comprise. En progressant à la « Position 7 », son salaire passe à 1 289 euros nets, et à la « Position 10 », il atteint 1 417 euros nets. Ces montants, qui concernent une part importante des effectifs, sont à peine supérieurs au seuil de pauvreté et illustrent la précarité qui touche même les employés d’une grande entreprise publique historique.
Le fossé entre les deux mondes est abyssal. Un PDG rémunéré à 450 000 euros bruts par an gagne environ 37 500 euros par mois. Cela signifie qu’il perçoit en une seule journée (environ 1 700 euros) plus que ce qu’un agent de « Position 10 » gagne en un mois entier. Le ratio entre la rémunération du plus haut dirigeant et celle d’un salarié en bas de l’échelle dépasse 25 pour 1. Cette comparaison n’est pas seulement une statistique ; elle est le reflet d’une fracture sociale et morale qui mine la cohésion de l’entreprise et, par extension, de la société.
Sources : Calculs basés sur les données de forums de cheminots et les rapports sur la rémunération des dirigeants
Cette disparité abyssale alimente un profond ressentiment. Elle rend indéfendable, aux yeux de beaucoup, la nomination d’un ancien Premier ministre à un poste si grassement payé, alors même que les salariés qu’il dirigerait luttent pour joindre les deux bouts. La question salariale n’est plus une simple question de gestion des ressources humaines ; elle est devenue un enjeu politique majeur, un symbole de l’inégalité systémique qui est au cœur de la crise française.
Des Géants aux Pieds d’Argile : Les Chantiers Stratégiques Ignorés
La focalisation du débat public et politique sur les noms et les salaires des futurs dirigeants a un effet pervers : elle occulte les défis opérationnels titanesques auxquels la SNCF et La Poste sont confrontées. Ces deux entreprises, piliers du service public français, sont à un tournant critique de leur histoire. Leur survie et leur modernisation exigent bien plus qu’une simple gestion politique ; elles requièrent une expertise industrielle et une vision stratégique de long terme. Or, le choix de dirigeants pour des raisons de proximité politique plutôt que de compétence opérationnelle avérée fait peser un risque majeur sur l’avenir de ces fleurons nationaux.
SNCF : Un Système Ferroviaire au Bord de la Rupture
Le réseau ferroviaire français, autrefois fierté nationale, est aujourd’hui un colosse vieillissant. Les défis sont immenses et touchent au cœur même de l’infrastructure.
La Dégradation de l’Infrastructure : Le problème le plus urgent est l’état du réseau lui-même. Un rapport sénatorial alarmant a souligné que, malgré des investissements en hausse, le financement actuel est insuffisant pour enrayer la dégradation des voies, des caténaires et de la signalisation. Le rapport estime qu’il manque au moins 1 milliard d’euros d’investissements supplémentaires chaque année, pendant dix ans, simplement pour maintenir le réseau en état. L’archaïsme de certaines parties du système est frappant : un tiers des 1 500 postes d’aiguillage du réseau principal sont encore actionnés manuellement, une situation impensable chez nos voisins européens comme l’Allemagne. Cette vétusté se traduit par des retards chroniques, une fiabilité en baisse et un risque sécuritaire croissant.
La Modernisation Technologique et la Concurrence : Parallèlement à cette nécessaire régénération, la SNCF doit mener une double révolution. D’une part, elle doit déployer des technologies de pointe extrêmement coûteuses, comme le système européen de gestion du trafic ERTMS ou la nouvelle génération de TGV (TGV M), pour rester compétitive. D’autre part, elle doit faire face à l’ouverture à la concurrence de ses lignes, d’abord pour les trains régionaux (TER) puis pour la grande vitesse, conformément aux directives européennes. Cette nouvelle donne concurrentielle exige une agilité et une efficacité commerciale que la culture historique de l’entreprise, marquée par son statut de monopole, a du mal à intégrer.
La Santé Financière : Bien que le groupe SNCF ait présenté des résultats financiers positifs ces dernières années, sa structure reste fragile. Il ploie sous une dette nette colossale, et sa rentabilité dépend fortement de la conjoncture économique et des subventions publiques. Le pilotage financier de l’entreprise est un exercice d’équilibriste permanent, entre la nécessité d’investir massivement et l’impératif de maîtriser les coûts.
La Poste : Réinventer un Modèle Économique
Pour La Poste, le défi est d’une autre nature mais tout aussi existentiel. Son métier historique, la distribution du courrier, est en déclin structurel et irréversible avec la digitalisation des communications. Le volume de lettres transportées chute d’année en année, rendant son modèle économique traditionnel obsolète. L’entreprise a entamé une diversification massive pour survivre, se transformant en un conglomérat de services : banque (La Banque Postale), assurance, logistique de colis (Geopost), téléphonie mobile et services de proximité pour les personnes âgées. Cette transformation est une course contre la montre. Elle nécessite une vision stratégique claire pour arbitrer entre des activités très diverses, investir dans les secteurs porteurs et gérer la reconversion de dizaines de milliers de postiers dont le métier est amené à disparaître.
Le Risque d’une Gouvernance Politique
Face à ces chantiers herculéens, la question centrale est celle de la compétence. Diriger la SNCF ou La Poste en 2025 n’est pas une sinécure honorifique. Cela exige une connaissance intime des enjeux industriels, technologiques, sociaux et financiers de secteurs en pleine mutation. La nomination d’un profil comme Jean Castex à la SNCF, aussi respectable soit son parcours de haut fonctionnaire et d’homme politique, soulève légitimement des interrogations. Son expérience est avant tout administrative et politique, pas industrielle ou ferroviaire. Le risque est que la gestion de l’entreprise soit dominée par des considérations politiques de court terme – gestion des relations avec les syndicats, arbitrages budgétaires avec l’État – au détriment de la stratégie industrielle de long terme.
Le drame des nominations politiques est qu’il détourne l’attention des vrais problèmes. Pendant que le microcosme parisien débat de l’identité du prochain PDG, le réseau ferroviaire continue de se dégrader, et la transformation de La Poste reste un défi permanent. Le « pantouflage » et la « politique des copains » ne sont pas seulement des problèmes moraux ou éthiques ; ils constituent une menace directe pour la compétence de l’État et la pérennité de ses services publics les plus essentiels.
Le Regard de l’Autre : La France, « l’Homme Malade » de l’Europe?
La crise politique française, avec ses gouvernements éphémères et ses institutions paralysées, n’est pas qu’une affaire intérieure. Observée depuis l’étranger, elle suscite un mélange d’incompréhension, d’inquiétude et parfois même de sarcasme. L’image d’une France stable et motrice de l’Europe s’est sérieusement écornée, laissant place à celle d’un pays imprévisible et replié sur ses propres dysfonctionnements. Ce regard extérieur, qu’il soit politique, médiatique ou économique, révèle l’impact concret de l’instabilité hexagonale sur la scène internationale.
« Chaos » et « Sitcom » : La Presse Internationale Stupéfaite
Les médias internationaux ont couvert la succession de crises gouvernementales en France avec des termes qui trahissent leur sidération. Des mots comme « chaos », « crise de la démocratie » sans précédent depuis De Gaulle, ou « situation sans précédent » reviennent en boucle dans les analyses de la presse anglo-saxonne, italienne ou allemande. La démission de Sébastien Lecornu après seulement un jour a été le point culminant de ce qui est perçu comme une farce tragique. Une diplomate européenne à Bruxelles, citée anonymement, a résumé le sentiment général en déclarant : « Je me suis crue dans un sitcom ce matin ». Cette remarque, bien que légère en apparence, traduit une profonde anxiété : la France, un des piliers de l’Union Européenne, n’est plus prise au sérieux. Le président Macron est quant à lui dépeint comme un « canard boiteux » .
L’Inquiétude de Bruxelles et de Berlin
Au-delà des médias, ce sont les partenaires européens de la France qui s’inquiètent le plus. À Bruxelles, la paralysie politique française est une source de préoccupation majeure. L’incapacité de la France à se doter d’un gouvernement stable et à voter un budget met en péril l’ensemble de la zone euro. Comme le souligne un eurodéputé, « la trajectoire de nos finances publiques est aujourd’hui un sujet d’immense préoccupation pour nos voisins européens », car « nos choix ont des conséquences pour la zone euro dans son ensemble ».
À Berlin, le partenaire historique, l’inquiétude est double. D’une part, la crise française affaiblit le moteur franco-allemand, essentiel au fonctionnement de l’UE. Comment prendre des décisions stratégiques à long terme, notamment sur des sujets aussi cruciaux que le soutien à l’Ukraine ou la transition écologique, avec un partenaire dont le gouvernement peut tomber à tout moment?. D’autre part, l’Allemagne observe avec une certaine angoisse la montée des forces politiques qu’elle juge extrémistes en France, craignant une contagion ou, à tout le moins, une divergence profonde des visions politiques au sein de l’Europe. La France n’est plus perçue comme un partenaire fiable, mais comme une source d’instabilité potentielle pour tout le continent.
Les Conséquences Économiques de l’Instabilité
Cette perte de crédibilité politique a des conséquences économiques très concrètes. Les marchés financiers, qui détestent l’incertitude, ont réagi négativement à la crise française.
La Sanction des Marchés : Le jour de la démission de Sébastien Lecornu, la Bourse de Paris a nettement sous-performé par rapport aux autres places européennes, le CAC 40 chutant de plus de 1,48%. Les valeurs bancaires françaises ont été particulièrement touchées, les investisseurs craignant que la crise politique ne se transforme en crise de la dette souveraine. Un indicateur clé de la confiance des investisseurs, le « spread » (l’écart entre les taux d’emprunt à 10 ans de la France et de l’Allemagne), s’est creusé pour atteindre des niveaux observés lors des pics de tension de la crise de la zone euro. Cela signifie que les investisseurs exigent une prime de risque plus élevée pour détenir de la dette française, ce qui alourdit le coût du financement de l’État.
La Chute de l’Attractivité : L’instabilité politique a également un impact direct sur l’attractivité du pays pour les investissements étrangers. Une enquête menée auprès des dirigeants de filiales américaines en France a révélé un effondrement de la confiance. En 2024, la proportion de patrons prêts à recommander d’investir en France a chuté de 22 points par rapport à l’année précédente. Seuls 39 % d’entre eux estiment que la perception de la France par leur maison mère est positive, une baisse de 13 points en un an. Le « chaos » politique fait fuir les capitaux et menace l’emploi.
La crise française n’est donc plus un spectacle politique réservé à un public national. Elle a des répercussions géopolitiques et économiques profondes. En affaiblissant son propre État, la France affaiblit sa position en Europe et dans le monde, créant un vide de leadership au moment où le continent fait face à des défis historiques. Le « sitcom » politique parisien a un coût, et c’est l’influence et la prospérité de la France qui en paient le prix.
La Route vers 2027 : Colère Sociale et Crise de Régime
L’épisode des nominations suspendues à la SNCF et à La Poste, bien plus qu’une simple péripétie administrative, est le symptôme d’un mal profond qui ronge la République française. Il révèle la convergence de multiples fractures – politique, sociale, et morale – qui transforment l’impasse actuelle en une véritable crise de régime. Le drame qui se joue au sommet de l’État n’est pas déconnecté des angoisses et de la colère qui montent du reste de la société. Au contraire, il les nourrit, créant un cercle vicieux de défiance et de paralysie qui prépare un avenir politique à haut risque.
Le Baril de Poudre Social
Sous la surface du théâtre politique parisien, le climat social est électrique. Les enquêtes d’opinion dessinent le portrait d’un pays profondément pessimiste et fracturé. Un sondage réalisé en septembre 2025 révèle que 70 % des « talents » français (cadres et professions intellectuelles) estiment que le pays est « en déclin », et 81 % se disent « inquiets » de la situation politique. Cette anxiété des élites fait écho à une colère plus large, ancrée dans un sentiment d’injustice fiscale et sociale. Une autre enquête montre un soutien écrasant (83 % des Français) à une taxation accrue des entreprises du secteur des énergies fossiles, et une large approbation (79 %) pour une baisse des charges sur les bas salaires. Ces chiffres ne sont pas de simples opinions ; ils traduisent une demande massive de rééquilibrage et une exaspération face à un système jugé inéquitable.
Cette colère trouve une expression organisée dans la réponse des syndicats. Fait rare, l’ensemble des grandes confédérations (CGT, CFDT, FO, UNSA, etc.) ont fait front commun pour dénoncer les projets d’austérité des gouvernements éphémères de Bayrou et Lecornu. Qualifiant les mesures envisagées (suppression de jours fériés, nouvelles coupes dans l’assurance chômage, gel des salaires des fonctionnaires) de « provocation » et de « régression sociale », elles ont appelé à des journées de mobilisation massive. La CGT a dénoncé le « choix du chaos institutionnel » fait par le président, affirmant que la rue peut faire plier le pouvoir. Cette unité syndicale, face à un pouvoir exécutif affaibli, signale un risque élevé de conflictualité sociale.
Le Risque d’Explosion et la Crise de Légitimité
Lorsque les canaux institutionnels de la politique semblent bloqués, la colère risque de déborder dans la rue. L’émergence de mouvements de protestation plus spontanés et radicaux, comme le mouvement « Bloquons Tout » qui a secoué plusieurs grandes villes à l’été et à l’automne 2025, est un indicateur de cette tension. La combinaison d’une paralysie politique au sommet, d’un sentiment d’injustice sociale à la base, et de la perception d’un système d’élites cooptées et déconnectées (incarné par les nominations de Castex et Debon) crée un cocktail potentiellement explosif. La crise n’est plus seulement politique ; elle est devenue une crise de légitimité du système dans son ensemble.
L’Horizon Incertain de 2027
Tous les acteurs politiques ont désormais les yeux rivés sur l’élection présidentielle de 2027. La crise actuelle n’est pas seulement une fin de règne chaotique ; elle est le terrain sur lequel se prépare la prochaine bataille. L’instabilité et la paralysie sont devenues le principal argument des forces politiques qui se présentent comme des alternatives radicales au « système ». Le Rassemblement National et La France Insoumise capitalisent sur le chaos pour affûter leurs discours de rupture, présentant le marasme actuel comme la preuve de la faillite d’un modèle politique à bout de souffle.
L’élection de 2027 ne se jouera probablement pas sur des nuances programmatiques, mais sur une confrontation brutale entre des blocs idéologiques qui considèrent que le compromis n’est plus possible. Le centre politique, qui a dominé la dernière décennie, risque d’être pulvérisé, non plus une base de pouvoir mais un champ de ruines.
Dans ce contexte, l’affaire des nominations suspendues restera comme un symbole puissant. Elle aura démontré l’impuissance d’un pouvoir présidentiel incapable d’imposer ses choix, la déconnexion d’une élite qui se répartit les postes au sommet pendant que le pays s’enfonce dans la crise, et la fragilité d’un modèle républicain qui peine à se réinventer. Le choix qui se profile pour la France n’est plus simplement celui d’un nouveau dirigeant, mais potentiellement celui d’une refondation, subie ou choisie, de la République elle-même.





