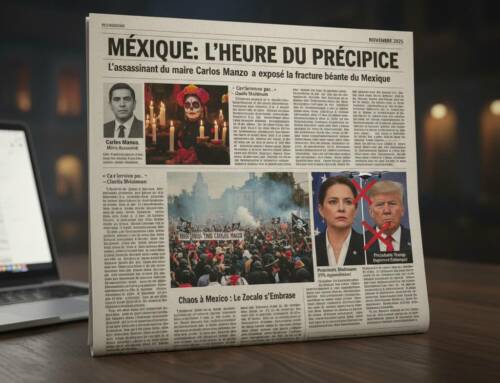Entre deux Trump : l’évolution d’un projet politique en 100 jours. Une version plus radicale du 45e président défie les institutions américaines et l’ordre mondial. Les cent premiers jours du second mandat de Donald Trump révèlent une transformation majeure par rapport à sa première présidence (2017-2021). Si le Trump de l’époque avait déjà opté pour un style disruptif, cette version 2.0 déploie une agenda plus cohérente, structurée et surtout radicalisée, tant sur le plan intérieur qu’international. Loin d’être une simple continuité, il s’agit d’une amplification délibérée du projet trumpiste, désormais affranchi des hésitations qui marquaient son premier passage à la Maison-Blanche.
Mais qu’est-ce que nous devons retenir un Président qui fait un Show à la Maison Blanche contre Zelensky puis un Président qui revient en arrière plus calme et écoutant à Saint Pierre de Rome.

Photo de Donald Trump de Wikipedia
Un pouvoir exécutif renforcé
Sur le plan national, la différence tient à une approche systématique pour défier les institutions et centraliser le pouvoir. Là où le premier mandat se caractérisait par des conflits improvisés avec les contre-pouvoirs (entraînant des revers judiciaires et des blocages administratifs), cette nouvelle administration démontre une redoutable efficacité pour remodeler l’appareil d’État :
-
Décrets présidentiels ciblés
-
Remplacement accéléré des hauts fonctionnaires par des loyalistes
-
Création du Département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE) : une structure directement rattachée à la présidence, dotée de pouvoirs transversaux sur les ministères.
Cette centralisation, souvent bloquée par le Congrès ou la justice lors du premier mandat, bénéficie désormais d’une sophistication juridique et politique inédite. La rhétorique anti-« État profond » (deep state) se concrétise par une subordination sans précédent de la bureaucratie fédérale à la vision présidentielle.
Une rupture géopolitique assumée
À l’international, le changement est tout aussi marqué. Si Trump I affichait déjà son rejet de l’ordre libéral post-1945, Trump II en accélère le démantèlement au profit d’une logique néo-mercantiliste :
-
Tarifs douaniers agressifs sur l’acier, l’aluminium, l’automobile et l’électronique – présentés non plus comme des outils de négociation, mais comme une politique économique permanente.
-
Réactivation de la doctrine Monroe : les récentes déclarations sur le « droit légitime » des États-Unis à influencer l’Amérique latine illustrent cette approche revancharde.
-
Abandon du multilatéralisme : réduction drastique des financements à l’ONU et critiques acerbes contre l’OTAN, perçues comme des « structures exploiteuses ».
Cette vision transactionnelle des relations internationales – où chaque partenariat est évalué à l’aune de bénéfices immédiats – s’accompagne d’une conception « zéro-sum » (les gains d’un pays = les pertes d’un autre), particulièrement visible dans les rapports avec la Chine et la Russie.
Une menace pour les institutions ?
Ces 100 jours ne sont pas un simple remake : ils dessinent un trumpisme plus structuré, plus radical et potentiellement plus durable. Deux questions émergent :
-
La démocratie américaine résistera-t-elle à cette concentration de pouvoir ?
-
Quel avenir pour un ordre mondial déjà fragilisé ?
Là où le premier Trump se heurtait souvent aux limites du système, le second démontre une capacité inquiétante à le transformer en profondeur.