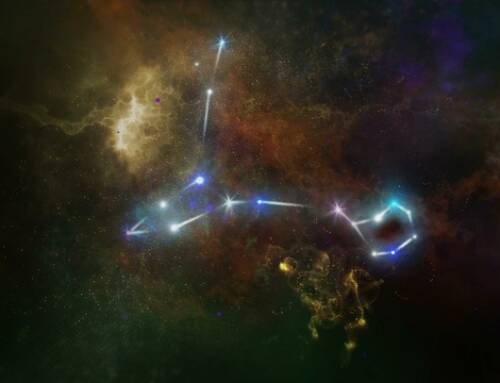Le Caporal Jimmy Gosselin mort en Guyane : L’enfer doré. 55 millions d’euros par an pour une guerre sans fin contre l’or illégal
En Guyane française, l’Opération Harpie mobilise des centaines de militaires dans une lutte acharnée contre l’orpaillage clandestin. Il faut que les orpailleurs sont brésiliens.
Mais malgré un budget colossal et le sacrifice des soldats, la France ne parvient qu’à « maintenir à bas niveau » un fléau qui dévore la forêt. Analyse d’un bourbier stratégique où « quelques kilos » d’or sont saisis face à près de dix tonnes produites illégalement chaque année.
Le prix du sang dans l’enfer vert
Le 3 Novembre 2025, le Caporal Jimmy Gosselin perdait la vie lors d’une opération. Son décès est venu rappeler le coût humain de l’Opération Harpie. Il n’est pas le seul. Tirs des orpailleurs contre les forces d’interventions, chutes d’arbres, produits toxiques que laissent les orpailleurs : les Forces Armées en Guyane (FAG) paient un lourd tribut.
La mission génère une usure physique et psychologique considérable. Les conditions en forêt équatoriale poussent les soldats à leurs limites.
Face à l’armée de l’ombre des « Garimpeiros »
Sur le terrain, les FAG ne font pas face à de simples mineurs isolés. Ils combattent de véritables « bandes organisées », aguerries et lourdement armées, qui ont pris le contrôle de pans entiers de la forêt. Le combat se déroule sur un territoire grand comme l’Autriche, où le temps et l’espace jouent constamment en faveur des clandestins.
Lancée en 2008, l’Opération Harpie, désormais pilotée au niveau interministériel par le préfet et le procureur, déploie pourtant des moyens importants, comme les assauts héliportés « Anaconda » visant à détruire le matériel.
Le paradoxe Harpie : contenir n’est pas vaincre
Malgré les efforts, le bilan révèle un paradoxe opérationnel. Si les sites illégaux ont été réduits par le passé, le résultat est précaire. Selon un rapport du Sénat, Harpie parvient tout juste à « maintenir l’orpaillage à bas niveau ». Un effort crucial, car sans lui, la forêt serait « littéralement décimée », mais qui coûte 55 millions d’euros par an au contribuable.
L’échec est avant tout logistique et économique. Les opérations sont limitées par un manque chronique d’hélicoptères de transport, essentiels pour la projection des forces. Surtout, les chiffres révèlent l’inefficacité de la stratégie actuelle :
- Production illégale estimée : 5 à 10 tonnes d’or par an.
- Saisies par les forces de l’ordre : « Quelques kilos par an ».
Ce ratio colossal démontre que la pression est trop faible. Tant que le marché final – le recel et le blanchiment – n’est pas ciblé, l’Opération Harpie agit davantage comme un facteur de coût pour l’État que comme un risque réel pour l’économie criminelle.
Une économie souterraine dopée par les cours mondiaux
Le cœur du problème est la résilience du « système garimpeiro ». Majoritairement brésiliens, ces mineurs informels ont développé un système socio-économique souple et très adaptable.
Ce système est aujourd’hui dopé par la hausse du cours de l’or (environ 50 000 euros le kilo), valeur refuge qui a bondi de 50 % depuis 2015. Cette flambée ne fait pas qu’augmenter la rentabilité des chantiers ; elle irrigue toute l’économie souterraine (carburant, transport, services). Chaque intermédiaire, souvent payé en or, voit son intérêt à participer au trafic augmenter.
Faut-il tirer à vue ? Le piège de l’escalade
Face à cette impasse, la question d’un usage de la force létale pour « dissuader » les orpailleurs refait surface. Une option jugée « sans aucun sens » pour certains mais pour d’autres elle va permettre de faire peur. Il est vrai qu’il s’introduise sur le territoire français et le détruit sans jamais être attrapé ou jugé.
Sur le territoire national, les militaires opèrent dans le cadre de la légitime défense (Article 122-5 du Code Pénal). Ils ne peuvent faire usage de leurs armes que pour répondre à une attaque immédiate, nécessaire et, surtout, proportionnelle.
Utiliser la force létale pour dissuader des fuyards ou des individus non menaçants est fondamentalement incompatible avec le droit français. Une telle doctrine exposerait les militaires à des poursuites pour homicide, saperait le moral des troupes et torpillerait la coopération diplomatique avec le Brésil, pourtant essentielle.
Les vraies solutions : assécher la filière
La véritable dissuasion n’est pas la létalité, mais la certitude de la sanction. Pour sortir de l’impasse, la France doit changer de doctrine et passer d’une logique militaire à une stratégie économique et judiciaire.
- Cibler les flux financiers : La priorité doit être donnée à la neutralisation des filières de recel et des axes logistiques (carburant, matériel). Cela passe par un renforcement des moyens d’enquête judiciaire et le développement urgent de la traçabilité de l’or.
- Renforcer la logistique : La disponibilité immédiate des hélicoptères (remplacement des vieux Puma par les Caracal) est une condition non négociable de l’efficacité opérationnelle.
- Coopérer avec le Brésil : La solution ne peut être que transfrontalière. Une coopération structurelle et permanente avec le Brésil est vitale pour partager le renseignement financier et éviter le repli des garimpeiros de l’autre côté de la frontière.
- Développer une alternative légale : L’État doit accélérer le développement d’une filière aurifère légale et responsable en Guyane, capable de capter la main-d’œuvre et de proposer une alternative crédible à l’économie criminelle.
C’est seulement en rendant l’orpaillage illégal financièrement insoutenable – et non seulement militairement risqué – que la France pourra honorer le sacrifice de ses soldats et reprendre pleinement la souveraineté sur son territoire amazonien.